Les Champs d’honneur
Jean Rouaud
Les Editions de Minuit, 1990
Le Jour,
En cet automne 1990, la lutte s’annonce très serrée pour l’attribution du prestigieux prix, entre Philippe Labro, directeur d’une station de radio, pour son roman Le petit garçon et Jean Rouaud, vendeur de journaux, pour Les Champs d’honneur. Le jury, sous la présidence d’Hervé Bazin, optera au final par huit voix contre deux pour Les Champs d’honneur, publié aux Editions de Minuit.
Un dem i-million d’exemplaires en moins de quatre mois seront vendus (au final 600 000 exemplaires)… C’est un grand succès populaire, adoubé par une critique unanime pour un roman de grand talent.
i-million d’exemplaires en moins de quatre mois seront vendus (au final 600 000 exemplaires)… C’est un grand succès populaire, adoubé par une critique unanime pour un roman de grand talent.
Comme le dit Jean Rouaud dans une interview… « J'avais une idée de la littérature qui passait par Minuit, les prix étaient pour moi presque synonymes d'une dévaluation, en tout cas d'une certaine reconnaissance, mais pas forcément littéraire. Et soudainement je découvre ma notoriété, que je suis une référence à l'étranger... Après, vous n'êtes plus jamais seul, partout vous êtes présenté comme le prix Goncourt. »
Le Goncourt,
C’est beau la littérature, quand elle est écrite comme cela, avec de longues phrases qui n’en finissent pas, souples et légères, consistantes, pour nous laisser entendre dans un premier temps que la pluie en Loire-Inférieure, « s’annonce à des signes très sûrs : le vent d’ouest, net et frais, les mouettes refluent très loin à l’intérieur des terres… les feuillages qui s’agitent et bruissent au vent… les hommes qui lèvent le nez vers un ciel pommelé… »
Ainsi, Les Champs d’honneur, un prix Goncourt 1990 inattendu, d’une force littéraire rare. La prose de Jean Rouaud, aux accents poétiques, nous enchante dès les premières lignes. Ainsi, la pluie, comme une toile de fond, un personnage chargé de nous introduire au roman, qui s’infiltre à l’intérieur de la 2cv d’Alphonse, un grand-père, violoniste amateur, du genre taiseux, taciturne, « Il semblait si absorbé, si lointain, qu’on pouvait le croire assoupi. »
Seul ou en compagnie de ses petits-enfants, ce grand-père parcourt les routes du pays nantais fouettées par les pluies de tempête qui « ont la volonté de faire place nette.» Climatiquement perturbé, le temps est à l’image d’une autre perturbation : celle de l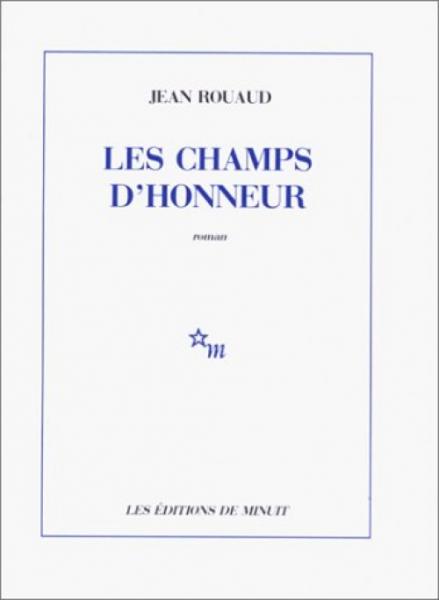 a mémoire d’une famille bretonne sur plusieurs générations, dont le grand-père est un des personnages.
a mémoire d’une famille bretonne sur plusieurs générations, dont le grand-père est un des personnages.
Un narrateur – marionnettiste habillement invisible – s’évertue à en raconter l’histoire. Au gré d’une écriture chafouine, sa quête l’amène à dénouer un à un les nœuds de l’écheveau familial. Soit un puzzle complexe où il se remémore « les petits faits obtus », des souvenirs qu’il associe et rassemble. Il écrit les silences, les malentendus, le moindre indice, en un récit qui n’est pas construit selon un ordre chronologique.
La famille évoquée, habite Random dans la Loire-inférieure à l’époque des années soixante. En ces années tranquilles, filtre un sentiment de paix et de liberté, jusqu’à ce que ne survienne « le drame »: la mort du père du narrateur à 40 ans, comme celles du grand-père Alphonse et de Marie ; tous les trois à quelques jours d’intervalle.
Marie, la grand-tante, est la clé introductive du roman, le personnage central. Ancienne institutrice, elle est la sœur de Pierre le miraculé de la guerre et de Joseph. Fantasque, obnubilée par sa dévotion à Dieu, elle est la mémoire de la famille avec ses petites manies de bigote. A sa mort, on retrouve « sous les différentes statues de saints qu’elle disposait dans les anfractuosités du mur du jardin, ainsi qu’au dos des cadres pieux de sa chambre, des dizaines de petits papiers pliés. Sur chacun d’eux une demande, un vœu à exaucer… »
Il n’est pas toujours aisé de suivre le récit de Jean Rouaud. Un sentiment de décousu s’en dégage, de tâtonnements, par le fait de vouloir éclaircir les obscurités de ses racines. On comprend que la mort de Joseph à 40 ans est le détonateur de la quête. Au fil des pages, se dessine un arbre généalogique avec des situations qui nous conduisent jusqu’aux portes de la Grande Guerre.
Aux origines, le mariage de Grand-père et de Grand-mère en 1912. Une sorte de mur de Planck. Avant on ne sait pas, il y a comme une rupture, comme s’il n’y avait pas d’importance à remonter le temps plus en amont. Comme si l’histoire de la famille n’était qu’un maillon parmi d’autres de l’Histoire collective et que c’était en cette temporalité-là, que tout devait démarrer.
Des bris de souvenirs nous apprennent que les frères de Marie, tout d’abord Joseph, est mort le 26 mai 1916 à l’âge de 21 ans et un an. La perte de Joseph imprime en elle, une « longue et secrète retenue de chagrin », et entraine l’arrêt de son flux menstruel « ce sang ravalé comme on ravale ses larmes, et par cette mort sa vie à jamais déréglée. » Un an plus tard, c’est au tour de son frère Emile, de mourir à la guerre.

Marie partage la douleur de sa belle-sœur Mathilde, « jeune veuve, mère du petit Rémi. » Et Pierre (troisième frère de Marie) se lance, le 5 février 1929, « au volant d’une voiture énorme », en compagnie d’Aline sa femme, à la recherche des restes d’Emile, soit disant identifiés au pied d’un eucalyptus dans la forêt de Commercy.
Quel imbroglio à travers les générations ! On ressent chez le narrateur, frère d’Aline et de Zizou, le grand amour qu’il porte aux siens, à ce père, Joseph, mort brutalement à 40 ans et dont le deuil incicatrisable passe par la fouille de la mémoire familiale. Au gré du récit, des éléments inédits voient le jour, comme lors de l’inhumation de Joseph où le fossoyeur retrouve le dentier en or d’Aline ainsi que les deux alliances d’Aline et Pierre en un moment symboliquement fort.
Comme tout grand roman, il y a dans Les Champs d’honneur de multiples entrées de lecture. Ainsi des passages très réalistes sur le quotidien des soldats et l’attente de la mort au fond des tranchées. Ces hommes, « ce grouillement de vers humains », qui écrivent une dernière fois sur des bouts de papier à ceux qu’ils aiment avant l’assaut mortel, ces soldats surpris pas l’arrivée des gaz (le gaz ypérite) et « l’intolérable brûlure aux yeux, au nez, à la gorge, de suffocantes douleurs dans la poitrine, une toux violente qui déchire la plèvre et les bronches, une bave de sang aux lèvres, le corps plié en deux secoué d’âcres vomissements, écroulés, recroquevillés, que la mort ramassera bientôt… » Les gaz pour tuer davantage, de façon rationnelle et économique.
Le roman de Jean Rouaud interpelle également la notion de famille, cet assemblage de personnes reliés par le sang, les racines, dont la volonté implicite ou affirmée est de s’en référer à une lignée. Même si les familles sont souvent handicapées par les non-dits et les malentendus ayant pour cause des complexités relationnelles.
La lecture de « Les Champs d’honneur » est jusqu’au bout poignante.
L’auteur,
Quel itinéraire que celui de Jean Rouaud !
En 1990, alors qu’il est kiosquier dans le 19ème arrondissement de Paris, le voilà du jour au lendemain, proclamé lauréat du prix Goncourt pour son premier roman Les Champs d’honneur. S’il est un inconnu dans le monde littéraire, on comprend très vite que ce sésame est loin d’être un hasard, que le destin vient de frapper à sa porte et qu’un grand écrivain vient de naître.
Jean Rouaud est né le 13 décembre 1952 à Campbon, « un bourg » du pays n antais imprégné de brumes océanes. Son père - de même que pour ses autres enfants - le pousse aux études. Au collège de Saint-Nazaire où il est pensionnaire, il obtiendra un bac scientifique. A la faculté de Nantes, une maitrise de lettres.
antais imprégné de brumes océanes. Son père - de même que pour ses autres enfants - le pousse aux études. Au collège de Saint-Nazaire où il est pensionnaire, il obtiendra un bac scientifique. A la faculté de Nantes, une maitrise de lettres.
En 1963, le lendemain de Noël, son père décède brutalement à l’âge de quarante et un ans, son père - si adulé « que vous ne savez pas trop comment l’aborder… son autorité en impose et vous cloue le bec1» -, un représentant de commerce, allant par monts et par vaux, vendre du matériel scolaire. Son père, un grand solitaire, un grand protecteur familial, tellement proche des siens.
A sa mort, Jean Rouaud a tout juste onze ans. Cette perte terrible, blessera son être en profondeur et sera probablement le déclic inconscient de son œuvre à venir ayant pour toile de fond le pays nantais.
Sa maitrise de lettres en poche, il se présente au monde du travail dont il se demande s’il est bien fait pour lui. Car, comment faire pour s’inscrire à l’intérieur de cette société cadrée par ses drastiques référents institutionnels jusqu’à en devenir à son tour un sujet docile. Il hésite quant à suivre les chemins de l’insertion collective. Il entre, sans y entrer tout à fait, dans l’espace social, en alternant les petits boulots (pompiste, vendeur d’encyclopédies médicales, télexiste à Presse-Océan, chroniqueur à l’Eclair de Nantes). Longtemps admiratif du général de Gaulle, en identification spirituelle avec son père disparu, son ressenti et ses idées évolueront par la suite, vers une sensibilité politique de gauche.
A la suite de Les Champs d’honneur, sillon princeps de son œuvre, Les Hommes illustres verront le jour en 1993, avec un portrait de Joseph, son père et l’évocation de ses années de vie familiales à Campbon, après la guerre et la guerre où celui-ci fut un héros de la résistance. En 1996, il publie Le monde à peu près (consacré au vécu de ses études comme pensionnaire au lycée Saint-Louis à Nantes, principalement la sixième et la cinquième). En 1998, il publie Pour vos cadeaux et Sur la scène comme au ciel en 1999, deux livres consacrés à la figure de sa mère qui termine le cycle de la généalogie familiale, publié aux Editions de Minuit, qu’il finit par quitter pour se rendre chez Gallimard.
D’autres livres, à caractère autobiographique viendront compléter ce monde sacralisé du pays nantais.
1 Des hommes illustres (Les éditions de Minuit).
Extrait du livre :
Après la mort de papa, c’est un sentiment d’abandon qui domine. Le cours des choses épousait sa pente paresseuse avec un sans-gêne barbare : jardin envahi par les herbes, allée bordée de mousses vertes, le buis qui n’est plus taillé, les dalles de la cour qui ne sont plus remplacées et où l’eau croupit, le mur de briques percé de trous, les objets en attente d’un rangement, les rafistolages dans un éternel provisoire. Plus rien ne s’opposait au lent dépérissement.
Dans les jours qui suivirent la mise en terre, Julien, le fossoyeur, rapporta à la maison trois objets de valeur qu’il avait exhumés du caveau familial : les deux alliances des parents de papa et le dentier en or de sa mère. Il déposa son trésor sur la table de la cuisine, timidement, avec l’humilité des réprouvés. C’était un ancien ouvrier agricole, le grade le plus bas dans la hiérarchie des campagnes, un loueur de ses bras qu’on couchait dans l’étable et qu’on salariait d’un couvert. Accéder au poste de fossoyeur municipal fut pour lui plus qu’une promotion inespérée, une sorte d’adoubement. Il avait été recruté sur une métaphore. Accompagnant son patron à sa dernière demeure, il aurait répondu au maire qui le sollicitait : « Les morts, c’est comme la semence, on met en terre et après tout dépend du ciel. » Peut-être en effet, est-ce parce qu’ils enterrèrent d’abord leurs morts que les premiers hommes, confiant en la résurrection, inventèrent des millénaires plus tard ce geste plein d’espérance d’enfouir des graines dans le sol. Quoiqu’il en soit, l’anecdote, rapportée, valut à Julien de la considération. On lui trouva de la profondeur, celle qui sied à la fréquentation des morts. Dans les commentaires, il se disait qu’au contact de la nature, la solitude atteint fréquemment à cette dimension cosmique – et cela paraissait plus évident que d’une pomme qui tombe, concevoir les lois de la gravitation universelle. La place de fossoyeur municipal était vacante, le maire et son conseil, impressionnés par ce parangon de la sagesse populaire, l’attribuèrent spontanément au journalier philosophe sans emploi.
Patrick Ottaviani (avril 2019)
 s Trompettes Marines
s Trompettes Marines  s Trompettes Marines
s Trompettes Marines